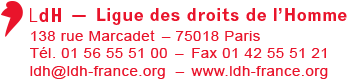Un texte d’Agnès Tricoire, Déléguée du groupe culture de la LDH.
Les censeurs disposent de nombreux outils pour interdire une œuvre, et cela qu’elle soit fictive ou réelle. Certaines datent de plus d’un siècle, d’autres ont été votées pendant la deuxième guerre mondiale, dans un contexte international compliqué. L’observatoire montre la face cachée de ces lois pour mieux en présenter les absurdités.Il existe une interdiction de contenu qui n’a quasiment pas été modifiée depuis la loi de protection de la jeunesse de 1949 : son article 2 interdit que les publications destinées à la jeunesse ne comportent « aucune illustration, aucun récit, aucune chronique, aucune rubrique, aucune insertion présentant sous un jour favorable le banditisme, le mensonge, le vol, la paresse, la lâcheté, la haine, la débauche, ou tout acte qualifié crime ou délit, ou de nature à démoraliser l’enfance ou la jeunesse », la loi du 29 novembre 1954 ayant ajouté « ou à aspirer ou entretenir des préjugés ethniques ». Ces publications « ne doivent comporter aucune publicité ou annonce pour les publications de nature à démoraliser l’enfance ou la jeunesse » tout cela sous peine d’une amende de 25 000 FF et d’un emprisonnement d’un an (article 7), outre la saisie et la destruction des exemplaires de l’œuvre interdite.
Ces publications sont soumises à un système de dépôt préalable et aucune ne peut être publiée sans déclaration préalable au ministère de l’Intérieur comportant le titre, les noms, prénoms et adresses des responsables de la publication (article 5) et, pour chaque livraison ou volume de la publication, dépôt de 5 exemplaires pour la commission de contrôle dès la publication ( article 6). Là encore, des peines sont prévues en cas de non respect de la procédure (articles 8 à 11).
Il y a certainement à réfléchir sur la pertinence d’une législation qui permet de vider les rayons BD et livre pour jeunesse des bibliothèques et des librairies !
* L’article 14 de la loi de 1881 sur la presse concerne également l’écrit, et permet au ministre de l’Intérieur d’interdire la circulation et la distribution ou la mise en vente en France de tout écrit rédigé en langue étrangère, ou bien de provenance étrangère rédigé en langue française, quelque soit le lieu de l’impression. Pour quels motifs ? La loi ne le dit pas. Mais s’il est enfreint à cette interdiction du ministère de l’Intérieur, les sanctions sont prévues : amendes, emprisonnement d’un an et saisie des exemplaires sont là pour rappeler qu’il s’agit d’une disposition pénale.
Si le ministre interdit une publication sur le fondement de cet ouvrage, le seul recours de l’éditeur ou de l’auteur interdit, est de saisir la juridiction administrative.
Que dit-elle ? Que cette disposition s’applique aux romans, que le ministre a bien fait d’interdire Sexus d’Henry Miller, auteur indiscutablement américain, et que le « caractère contraire aux bonnes mœurs » de ce livre a justifié la décision d’interdiction en raison du danger qu’il représente pour l’ordre public. Le Conseil d’État refuse de discuter de l’opportunité de cette décision . Même si l’article 14 ne dit pas pourquoi le ministre peut sévir, et en dépit de l’exposé les motifs du décret du 6 mai 1939 qui indique que ce texte a pour objet de faciliter la lutte contre « les propagandes subversives menées en France par voie de la presse étrangère » et de remédier aux insuffisances de la législation antérieure « dans un but d’ordre public et de défense nationale ».
L’article 14 a servi à interdire aussi, outre de nombreux romans :
– une revue éditée dans plusieurs pays à la fois, comportant des textes de solidarité entre les peuples d’Afrique, d’Asie et d’Amérique Latine, par la librairie François MASPERO qui fait l’objet d’une interdiction en date du 23 novembre 1968, confirmée par le Conseil d’État le 02 novembre 1973 , qui vérifie seulement que la décision n’est pas entachée d’erreur manifeste :
– une revue comportant des textes politiques de nature à compromettre les intérêts diplomatiques de la France , ce qu’a sanctionné le Tribunal Administratif de PARIS en 1989. On voit là que la juridiction administrative s’autorise en matière de politique étrangère et de diplomatie ce qu’elle s’était interdit pendant des années en matière de bonnes mœurs.
– L’ascension de Mobutu, ce livre étant de « nature à nuire à la conduite des relations entre la France et le Zaïre » , motivation dont on peut douter de la compatibilité avec l’article 10 de la CEDH depuis la sanction de la France du fait du délit d’offense à chef d’État étranger .
– en revanche, dire de la revue allemande SIGNAL diffusée en France de 1940 à 1944 qu’elle est « destinée à favoriser la renaissance de l’idéologie nationale socialiste » est une « erreur manifeste d’appréciation », justifiant l’annulation de l’arrêté d’interdiction .
Cet article a été condamné par la Cour Européenne des Droits de l’Homme, ce qui suscita le commentaire suivant : « les autorités françaises devraient désormais s’abstenir de faire application d’un pouvoir d’interdiction très contestable… mieux, elle devrait supprimer cette loi sur la liberté de la presse, les dispositions ainsi sanctionnées par le Juge Européen » » .
* L’article 14 de la loi du 16 juillet 1949 instaure un régime préventif aléatoire pour les publications non destinées à la jeunesse mais qui, à raison de leur contenu, peuvent faire l’objet de restrictions plus ou moins sévères de diffusion par arrêté du ministre de l’intérieur, dans l’année qui suit leur dépôt légal ou leur publication.
Les interdictions possibles :
La première mesure, l’interdiction de vente aux mineurs, est, de l’avis des professionnels, la signature de l’arrêt de mort de la diffusion du livre, presque autant que les deux autres, soit par ce que les libraires refusent de faire un travail de policier, et de demander aux jeunes qui s’intéressent à la littérature contemporaine, et qui ne sont pas légion, leurs papiers, soit par ce que du fait de la masse de livres qu’ils ont à vendre, ils n’ont pas de temps, et renvoient l’ouvrage interdit à l’éditeur sans le mettre en vente.
La deuxième, l’interdiction d’exposition, ne permet que la vente par correspondance.
Quant à la troisième, qui interdit le livre de publicité, si un livre peut être diffusé dans ces conditions, (car les mesures se cumulent toujours dans ce sens) ce ne peut être qu’aux amis proches de l’auteur et de l’éditeur.
Lorsqu’une interdiction a été prononcée, un vendeur peut refuser de diffuser la publication ; si deux interdictions sont prononcées, la publication est exclue de la diffusion par les messageries de presse. Enfin, quand deux interdictions frappent trois publications du même éditeur en moins de douze mois, celui-ci est soumis au régime du dépôt préalable.
Lorsqu’un éditeur a vu trois publications interdites dans la même année, il est assujetti à un dépôt légal au ministère de la Justice pendant cinq ans, pour toute publication « analogue ».
Les motifs d’interdictions n’ont cessé d’augmenter depuis plus de cinquante ans : le caractère licencieux ou pornographique, et la place faite au crime (1949), la violence (loi 67-17 du 4 janvier 1967), « la discrimination, la haine raciale, l’incitation à l’usage, à la détention ou au trafic de stupéfiants »( loi 87-1157 du 31 décembre 1987).
La Commission de surveillance de publications destinées à la jeunesse ne peut ici que donner un avis si le ministre le lui demande. Jérôme Lindon s’était battu pour que les éditeurs « littéraires », « las de comparaître, par livres interposés, devant la commission, qui n’a pas vocation littéraire particulière et qui les juge comme s’ils étaient des trafiquants de drogue ou des vendeurs de cartes postales obscènes » puissent siéger à la commission, dans laquelle il les représenta dès 1967.
Mais la présence d’éditeurs « littéraires » n’a rien changé à la dichotomie entre éditeurs et décisions du ministre prises sur le fondement de l’article 14, car le ministre de l’Intérieur n’est pas obligé de recourir à l’avis de la commission chargée de la surveillance et du contrôle des publications destinées à la jeunesse , la loi n’exigeant pas cette procédure . La commission a donc seulement la possibilité de signaler au ministre de l’Intérieur les publications qui lui paraissent justifier les interdictions édictées à l’article 14. Et, si le Ministre décide de la consulter, elle n’a qu’un avis consultatif.
A propos de l’application de cet article dans l’affaire Rose Bonbon, le Syndicat National de l’Édition qualifiait toute mesure de ce type d’ « incongrue, inutile et dangereuse », contestant que le libraire doivent demander ses papiers aux jeunes souhaitant acquérir ce livre, « quand ils ont accès à Pierre Louys, Bataille, Naboukov ou Bernard Noel » (dépêche AFP du 8 octobre 2002).
* la censure du parquet : Les articles 227-23 et 227-24 du Code pénal
L’article 227-23
Lors des premières discussions de ce texte au parlement, l’article 227-23 ne visait que les images de mineurs, et non pas les représentations de mineurs, et ne visait à les interdire que lorsqu’elles étaient pornographiques .
Le terme « image » ne souffre pas d’ambiguïté.
Il s’agit de l’image d’un enfant capturé par un moyen technique comme la photographie, la vidéo ou le film. « Il est évident que le législateur a eu en vue…les images des mineurs prises in vivo, ainsi que l’évoquent d’une part, les mots « fixer » et « enregistrer » se référant directement à la photographie et au cinéma, et, d’autre part, le fait que ce soient les mêmes mots que ceux qui sont employés à propos de l’atteinte à l’intimité de la vie privée, où il s’agit bien d’une appréhension directe » .
C’est pourquoi en 1998, le législateur ajoute le délit matériel de « représentation ». Terme autrement plus ambigu. Charles Jolibois, auteur de cet amendement, explique qu’il s’agit de réprimer les images virtuelles . Il faut le lire en comparaison avec celui de « message » de l’article 227-24 qui inclut non seulement les images mais les écrits et les paroles .
Si le terme de représentation est utilisé ici, et non pas celui de message, c’est donc que le législateur a voulu rester dans le domaine de l’image, et ajouter à l’image réelle l’image virtuelle, exclusivement.
La question qui nous préoccupe au sein de l’Observatoire est la suivante :
Le terme de représentation de l’article 227-23 peut-il s’appliquer à une représentation artistique ?
Et doit-on soumettre les artistes auteurs de telles représentations à une expertise médicale, l’expert étant interrogé sur l’opportunité d’une injonction de soins dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire (article 706-47) ? Comment réaliser l’expertise pour évaluer le préjudice subi par les victimes mineures (article 706-48) ?
Les apologues de la répression jusque dans le cœur des oeuvres seraient-ils prêts à demander que les écrivains, les cinéastes et les artistes « déviants » soient soumis à une expertise médicale? Va-t-on créer des camps de redressement psychiatrique, comme en Chine, pour réhabiliter les fauteurs de troubles?
Va-t-on pouvoir poursuivre toutes les oeuvres déjà en circulation depuis 3 ans, voir faire de cet article un délit continu, ou qui se répètera à chaque nouvelle diffusion de l’œuvre, ce qui permettrait par exemple de brûler toutes les oeuvres « pornographiques » de Balthus ?
L’article 227-24
Le décret loi du 29 juillet 1939 qui figurait dans un chapitre 3 du code pénal intitulé délicatement « protection de la race » punissait « tous imprimés, tous écrits, tous dessins, objets ou images contraires aux bonnes mœurs », et devint l’article 283 du Code Pénal figurant dans le chapitre « crimes et délits contre les personnes » punissant l’outrage aux bonnes mœurs d’un mois à deux ans de prison et d’une amende de 360 à 30.000 FF.
Entrait dans le domaine d’application de l’article 283 du Code Pénal « toute manifestation de la pensée ou de l’image qui, sans mériter la qualification d’obscène, et sans être spécialement licencieuse, fait appel, par son caractère offensant pour la pudeur, à la recherche systématique d’une excitation érotique aux instincts et aux appétits les plus grossiers de l’être humain » .
L’article L 227-24, qui figure désormais dans la partie du code pénal concernant les mineurs, n’était pas prévu dans le projet gouvernemental du Nouveau Code Pénal et a été ajouté par la Commission Mixte à l’initiative de la fédération des familles de France . Il réprime les délits par voie de presse beaucoup plus largement que l’outrage aux bonnes mœurs : sont désormais pénalement répréhensibles les messages violents, pornographiques ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine lorsque ces messages sont susceptibles d’être vus ou perçus par un mineur.
Avant l’article 227-24, le fait que la victime de l’outrage aux bonnes mœurs fut un mineur était une circonstance aggravante de l’infraction et doublait les peines normalement applicables. L’article 227-24 en fait un élément matériel du délit, et sanctionne donc, non plus le message en raison de sa seule nature, mais la violence que peut constituer, à raison de son contenu, le message, pour un mineur.
Peut-on en déduire pour autant que « nous voyons ainsi que la protection de la liberté d’expression, déjà fortement garantie par le législateur de 1881, a été renforcée, sous certains aspects, par l’évolution de la législation récente » ?
L’article 227-24 a permis de sanctionner la presse pour des articles sur le tourisme sexuel, la pédophilie au Japon et la prostitution infantile au Brésil .
Quand le Tribunal indique dans la première affaire que « l’article en cause tente de banaliser et innocenter les relations sexuelles entre adultes et mineurs, par le recours à des journalistiques légères, par des jeux de mots, par l’évidence de certaines propositions », il semble indiquer que l’évocation seule de ces faits ne serait pas répréhensible, mais que l’apologie de ces pratiques sexuelles qualifiées par le Tribunal de « perversions dégradantes » et le recours à des titres « pernicieux pour attirer le public », sont constitutives du délit. Or, si l’on comprend ici le recours à la notion d’apologie comme une interprétation apparemment restrictive de l’article 227-24, lequel ne comporte pas de critère évaluatif du contenu du message, cette notion, appliquée à une oeuvre fictionnelle, est inopérante, car elle est ontologiquement antithétique, on y reviendra.
Le droit d’auteur n’est-il d’aucun secours pour éviter aux oeuvres la sanction de l’article 227-24 ?
La Cour de Cassation a affirmé la protection par le droit d’auteur d’une oeuvre pornographique, mais laisse entendre que le film n’est protégeable par le droit d’auteur que s’il n’est pas constitutif d’un outrage aux bonnes mœurs au sens de l’article 283 du Code Pénal ancien, applicable aux faits de l’espèce .
Un commentaire critique reproche à la Cour de Cassation de ne pas avoir exclu que le caractère illicite d’une oeuvre puisse la priver de la protection généralement accordée au titre de la propriété littéraire et artistique alors que « en aucun cas, la preuve du caractère dégradant d’une oeuvre pour la personne humaine ne peut fonder un droit pour le contrefacteur à l’exploiter librement » , et nous nous y associons.
Mais nous ne pouvons le suivre lorsqu’il affirme qu’une oeuvre doit être assujettie aux mêmes contraintes que la communication en général. Une oeuvre de fiction n’est ni une information, ni un discours politique, ni une publicité (même si toutes ces formes de communication peuvent être protégées par le droit d’auteur). Elle ne peut avoir pour obligation de respecter la morale ou les bonnes mœurs.
Appliquer cet article aux oeuvres, c’est, en vertu de concepts mous et fluctuants, suggérer d’interdire Sade (désormais disponible en Pléïade), mais aussi tout Victor HUGO, et en premier lieu Les Misérables, car le personnage de Ténardier ne porte-t-il pas gravement atteinte à la dignité humaine? Et L’homme qui rit n’est-il pas la victime de la violence et de l’indignité des hommes? Il faudrait aussi brûler la série noire, pour sa violence, faire aussi des autodafés de Gilbert Cesbron, interdire tous les films qui, comportant des scènes pornographiques, violentes, détruire toutes les collections des musées autres que les natures mortes, garder des contemporains les conceptuels, et les abstraits, quoique ceux-là aussi sont jugés très indignes par certains?
Si pour prendre la définition la plus consensuelle, la dignité humaine, « c’est la réunion symbolique de tous les hommes dans ce qu’ils ont de commun, à savoir leur qualité d’être humain » , est-ce qu’elle peut être touchée par une atteinte fictionnelle, et donc symbolique?
Est-ce que les oeuvres n’ont le droit que de déroger symboliquement à cette belle unité symbolique, pour montrer la noirceur de la nature humaine?
Si la réponse est négative, nous nous préparons des lendemains culturels qui chantent, car tout ce qui sera autorisé ne pourra être plus toxique que « La petite maison dans la prairie ».
C’est pourquoi il convient de saluer le jugement du TGI de Carpentras qui prend le parti d’exclure l’œuvre littéraire et le roman du champ d’application de l’article 227-24 : « Pour caractériser l’élément matériel de l’infraction, il convient de démontrer que celui-ci n’est ni un roman, ni une oeuvre littéraire, mais bien un écrit spécifiquement pornographique… si le propos litigieux développé par l’auteur défendeur agrémenté de scènes sexuelles complaisamment décrites, peut certainement apparaître incongru, choquant, ou révoltant, l’ouvrage en cause n’en est pas pour autant dénué de toute valeur artistique ou littéraire, ainsi d’ailleurs l’on estimé nombre de critiques et de journalistes » .
Et on excusera une faiblesse : s’il affirme qu’une oeuvre de fiction n’est pas un message (ce qui ne manque pas d’un certain courage), on ne peut en aucun cas lier la protection de l’œuvre à son mérite. Un mauvais roman a le droit de parler de pornographie, un mauvais film peut être violent, un mauvais tableau peut aborder le thème le plus indigne. Houellebecq aurait été honni par la critique qu’il devait être épargné.
* L’article 24 de la loi de 1881 sur la presse, sur l’apologie de certains crimes ou délits.
Cet article est visé dans les plaintes déposées à ce jour contre les romans Rose Bonbon et « il entrerait dans la légende ».
Or son objet est de réprimer les publications qui font l’apologie des atteintes volontaires à la vie, à l’intégrité de la personne et des relations sexuelles notamment.
S’agissant de liberté de création, cet article n’a pas vocation à s’appliquer à tout ce qui est oeuvre de fiction : il est absurde de considérer qu’une oeuvre puisse faire une apologie quelconque.
Dès lors que l’œuvre est d’imagination, qu’elle fonde un monde irréel, avec des personnages fictionnels, les propos sont irréels et ne peuvent donc être, par essence, apologétiques.
Le dispositif fictionnel est le garde fou de l’apologie : la mise à distance, avec son double, la possible identification, s’inscrivent dans un jeu conscient : même si je m’identifie à elle, je sais que je ne suis pas Madame Bovary.
Cet article ne peut avoir pour vocation que de s’appliquer au discours journalistique ou politique qui provoquerait, par la littéralité d’une présentation favorable, à commettre l’un des crimes précités.
* *
*
Il y a peu de chance que nous puissions rendre compte de l’intégralité de notre problématique à ne parler que de droit.
Il faut prendre en compte tous les autres moyens de restreindre la circulation d’une œuvre : la disparition du débat critique et de l’analyse politique du contenu des œuvres, (cf l’article de Christophe Domino et notre débat sur Houellebecq avec Dominique Noguez), la difficulté d’être lecteur (voir l’article de Bertrand Leclair), l’économie, qui, quand elle est outrageusement libérale, est aussi facteur d’entrave à l’accès à l’œuvre, lorsqu’elle noie les œuvres dans un flot de marchandises, ou pire, les transforme en produits (articles de Christophe Kantcheff et d’Eric Tandy)…
Bref, l’Observatoire veut changer le monde, comme tous les ligueurs, pas vrai ?