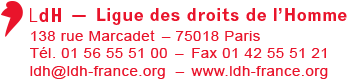Introduction, par Michel Tubiana
Michel Tubiana rappelle que, depuis la publication des interviews et du livre d’Aussaresses, le débat a été relancé sur la torture pratiquée par des militaires français pendant la guerre d’Algérie. La LDH a demandé au président de la République que la légion d’honneur lui soit retirée (procédure qui vient d’être entamée sous la forme d’une suspension) et déposé une plainte pour apologie de crimes et de crimes de guerre. Il ne s’agit pas de lui reprocher d’avoir révélé des faits de torture, mais bien d’avoir défendu comme normales ces pratiques. La FIDH, de son côté, en coordination avec la LDH, a déposé plainte pour crimes contre l’humanité, ce qui est plus difficile à faire entendre à la justice française et fait débat quant à cette qualification juridique des faits.
Il rappelle qu’il s’agit d’un séminaire de réflexion, sur invitation personnelle, rassemblant des personnes membres ou non de la LDH, qui vise à favoriser un échange entièrement libre entre les participants sur la qualification des faits, la réflexion sur les responsabilités et les propositions qui pourraient être formulées pour que la République assume ses responsabilités en conformité avec les idées de justice et de droits de l’Homme dont elle se réclame. Il ne s’agit pas d’un nouveau collectif destiné à prendre une quelconque position publique ; les débats ne seront pas publiés ; ils n’ont pas vocation à produire un position commune ; chacun en tirera les conclusion qu’il veut.
Malgré sa plainte pour apologie de crimes contre Aussaresses et la plainte de la FIDH, la LDH ne croit pas que le recours à la justice puisse remplacer l’effort d’information, de réflexion et d’action devant l’opinion publique qui reste l’objectif prioritaire en la matière. D’une manière générale, elle met l’accent sur l’approche politique par rapport à l’approche juridique. Elle constate, en l’état du droit existant, la probable impossibilité juridique de procédures judiciaires concernant des faits antérieurs à 1994. Mais la LDH a non seulement pour but de demander l’application du droit existant mais aussi de faire progresser le droit, compte tenu des avancées du droit international auxquelles la FIDH est particulièrement attentive. Le problème reste posé de la qualification des crimes commis en Algérie par l’armée et des initiatives publiques à prendre.
Quelques réflexions et propositions soumises au débat, par Gilles Manceron
Faut-il qualifier ces faits de crimes contre l’humanité ou de crimes de guerre, dans la définition qu’en donnent les textes juridiques internationaux et français ? Si, une fois qualifiés, ces faits ne pouvaient pas être jugés (en raison des amnisties, de la prescription, de la non rétroactivité de lois comme le Code pénal de 1994…), pourrait-on se satisfaire d’une situation où des faits extrêmement graves seraient établis et où ils échapperaient à tout jugement ou stigmatisation solennelle ?
Quelle demande doit-on formuler en s’adressant aux autorités de la République ? L’Appel des douze de L’Humanité demande qu’elle reconnaisse que la torture a été pratiquée dans des conditions qui mettent en cause sa responsabilité, ce qui est très important. Mais doit-on aller au-delà en lui demandant de reconnaître sa responsabilité plus large d’avoir mené une guerre coloniale en Algérie, ou d’avoir prétendu conduire des peuples vers le progrès en les colonisant ? Faut-il proposer une qualification du colonialisme comme « crime contre l’humanité et les droits de l’homme » (voir celles qui ont visé l’esclavage ou l’apartheid), distincte de la qualification juridique du crime contre l’humanité dans le traité de Londres et les conventions internationales ? C’est la République qui a porté le projet colonial (même si celui-ci a toujours fait l’objet de débats en son sein), et il a été lié à une certaine représentation de la hiérarchie des races : ne doit-on pas lui demander de revisiter cette page de son histoire pour dire que ce n’était pas conforme à ses valeurs ?
Quelles propositions pourrait-on faire pour faire avancer les choses dans la société française ? Dans le cadre de son approche politique qui prime sur l’approche juridique, pour la LDH, ce sont le contenu de l’enseignement, les gestes politiques symboliques, la création de lieux et moments de souvenir qui importent avant tout. Si l’on écarte l’idée d’une commission d’enquête parlementaire, d’une commission d’historiens (du type de la mission Mattéoli) ou d’une commission vérité-réconciliation du type de l’Afrique du Sud (accordant l’impunité contre l’aveu), ne pourrait-on pas proposer une commission vérité-justice ? Son but serait de répondre au besoin de vérité et de justice là où les tribunaux ne peuvent pas être saisis. Car sans cela, le droit des victimes ou de leur famille et le droit à la vérité des nouvelles générations risque d’être bafoué. Son objet précis resterait à définir : pour recueillir les témoignages des victimes ? les témoignages de militaires français et autres témoins et acteurs ? conduire à des matériaux et propositions pour l’enseignement ? proposer la création de lieux ou moments de mémoire ? d’un musée de la colonisation ? valoriser l’action des « justes » (pieds-noirs victimes de l’OAS, militaires refusant la torture, soldats insoumis, Français anticolonialistes…) ? susciter des productions cinématographiques et audiovisuelles ? proposer des mesures de réparation ? ou d’autres objectifs ? Quel type de participants une telle commission pourrait-elle réunir ?
Exposé historique, par Madeleine Rebérioux
Sur la question des archives, Madeleine Rebérioux explique que plusieurs fonds sont disponibles (le discours sur la fermeture des archives cache parfois la paresse de chercher). Elle n’est pas favorable à l’ouverture des archives à tout le monde sans aucun contrôle, notamment en raison de la nécessité de protéger les personnes. La question de l’organisation de l’accès aux archives se pose donc. L’institution d’un responsable par ministère, ceux-ci pouvant être rassemblés dans une commission, va dans le bon sens. Il faut organiser et harmoniser cet accès.
Elle rappelle que la guerre d’Algérie a commencé en 1945 et a été la plus tragique et la plus folle des guerres coloniales. On ne peut pas isoler tel ou tel événement comme le 17 octobre 1961 de l’ensemble de la guerre d’Algérie. Le problème essentiel est l’institutionnalisation de la torture (que montrent très bien les thèses de Sylvie Thénault et Raphaëlle Branche), qui met en cause non seulement des responsabilités individuelles mais aussi celles d’institutions et de forces politiques.
Faut-il qualifier la colonisation de crime contre l’humanité ? Madeleine Rebérioux pense plutôt qu’il faut désigner clairement le système colonial, défini comme un mode de production économique et de domination sociale et politique, et se demander pourquoi la République a été insensible à la mise en place de ce système ? Mais la colonisation de l’Algérie a été un épisode spécifique de la colonisation, marqué notamment par l’installation d’une minorité européenne opposée à toute réforme, par le vol et le viol des terres indigènes, et une situation économique et sanitaire qui a permis à la population de passer de 3 millions à 9 millions d’habitants entre 1830 et 1962.
Il ne faut pas qu’Aussaresses ou Bigeard soient des figures qui nous empêchent de reconnaître les problèmes essentiels, qui sont, en particulier, comment réinsérer dans l’enseignement scolaire l’histoire de la colonisation, et comment faire pour faire bouger les choses en Algérie aujourd’hui.
Exposé juridique, par Henri Leclerc
Henri Leclerc confirme que l’aspect juridique de notre réflexion est secondaire par rapport à l’aspect politique. La torture est un crime qui « bouleverse la conscience humaine ». Cela veut-il dire qu’elle entre dans la qualification juridique du « crime contre l’humanité » ? Selon Henri Leclerc, du point de vue juridique, la torture pratiquée par l’armée française en Algérie relève du crime de guerre et non du crime contre l’humanité (comme le défend Michel Zaoui dans son article dans Le Monde du 19 juin 2001). Le Code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994 définit le génocide (chapitre 1er, art. 211-1) comme « la destruction totale ou partielle d’un groupe national, ethnique, racial ou religieux… », puis les « autres crimes contre l’humanité » (chapitre 2, art. 212-1), comme « la déportation, la réduction en esclavage ou la pratique massive d’exécutions sommaires, d’enlèvements de personnes suivis de la disparition, de la torture ou d’actes inhumains inspirés par des motifs politiques, philosophiques, raciaux ou religieux et organisés en exécution d’un plan concerté à l’encontre d’un groupe de population civile… ». Pour Henri Leclerc, le crime contre l’humanité correspond donc toujours à une décision d’un pouvoir central de frapper une population civile donnée, décision suivie de conséquences massives sur celle-ci. En ce qui concerne le massacre du 17 octobre 1961 (environ 200 personnes), il y a un débat entre juristes sur la qualification comme « crime contre l’humanité », car il y a eu de la part des forces de police, en de nombreux endroits, une volonté de tuer identique. Mais, la torture et les exactions perpétrées par l’armée française en Algérie ne relèvent pas d’un plan pour tuer massivement et systématiquement une population civile. Ils correspondent aux définitions du crime de guerre dans plusieurs textes internationaux dont la Convention de l’ONU du 26 novembre 1968 et la Convention du Conseil de l’Europe du 25 janvier 1974. Quant à l’interprétation de la Cour de cassation, elle a évolué depuis l’arrêt Barbie de 1985 qui définissait le crime contre l’humanité comme « les actes inhumains et les persécutions qui, au nom d’un État pratiquant une politique d’hégémonie idéologique, ont été commis de façon systématique, non seulement contre des personnes en raison de leur appartenance à une collectivité raciale ou religieuse, mais aussi contre les adversaires de cette politique… ». Il y a eu depuis l’arrêt Boudarel, puis deux arrêts récents (Lakdar Toumi et Yakoub) qui ont donné une interprétation plus large de la notion de crime contre l’humanité.
En ce qui concerne l’amnistie, elle est d’abord dans les accords d’Evian, qui ont été ratifiés par la loi référendaire du 13 avril 1962, dans deux passages : dans la partie intitulée « Des droits et libertés des personnes et de leurs garanties » : « Nul ne pourra faire l’objet de mesure de police ou de justice, de sanctions disciplinaires ou d’une discrimination quelconque en raison […] d’actes commis à l’occasion des mêmes événements avant le jour de la proclamation du cessez-le-feu » ; et dans la « Déclaration des garanties », première partie : « Nul ne peut être inquiété, recherché, poursuivi, condamné ni faire l’objet de décision pénale, de sanction disciplinaire ou de discrimination quelconque, en raison d’actes commis en relation avec les événements politiques survenus en Algérie avant le jour de la proclamation du cessez-le-feu ». Par ailleurs, deux décrets du 22 mars 1962 ont amnistié, l’un, l’aide à l’insurrection, l’autre, les « infractions dans le cadre des opérations de maintien de l’ordre ». S’y sont ajoutés une ordonnance du président de la République du 14 avril 1962 ; une grâce présidentielle du 21 décembre 1964 (OAS) ; l’amnistie du 17 juin 1966 d’« infractions à la sûreté de l’État » (OAS) ; celle du 31 juillet 1968 (OAS) ; celle du 16 juillet 1974 (qui levait notamment les poursuites contre les déserteurs français) ; et la loi du 29 septembre 1982 (OAS). Ces amnisties sont autant d’obstacles juridiques à d’éventuelles poursuites d’aujourd’hui.
Débat
Ont participé au débat : Patrick Baudouin (ancien président de la FIDH), Mehdi Lalaoui (association Au nom de la mémoire), Jean-Paul Jean (Mission de recherche droit et justice), Olivier Le Cour Grandmaison (association 17 octobre contre l’oubli), Jean-Paul Hébert (chercheur à l’EHESS, spécialiste des questions de défense), René Gallissot (Institut Maghreb-Europe de Paris VIII), Françoise Banat-Berger (directrice des archives au Ministère de la justice), Patrick Éveno (Université Paris I, collaborateur du Monde), Charles Silvestre (L’Humanité), Gilles Manceron (LDH, responsable du colloque « Mémoire et enseignement de la guerre d’Algérie » en 1992), Pierre Dabezies (général, opposant à la pratique de la torture pendant la guerre d’Algérie), Pascal Blanchard (chercheur sur la colonisation, ACHAC), Madeleine Rebérioux (présidente d’honneur de la LDH, signataire de l’Appel des douze), Paul-François Ryziger (avocat à la Cour de cassation, LDH), Jean-Jacques De Felice (avocat, ancien défenseur des dirigeants du FLN, LDH), Sylvie Thénault (historienne, auteur d’une thèse sur la justice durant la guerre d’Algérie), Henri Leclerc (président d’honneur de la LDH) et Catherine Teitgen-Colly (juriste, Paris I).
Conclusions, par Michel Tubiana
Le débat a été très riche et a montré que nous devons prendre des initiatives pour prolonger et faire rebondir le débat de manière publique. Sans être tout à fait d’accord avec Sylvie Thénault, par exemple, qui sous-estime peut-être le rôle pédagogique et solennel de certains grands procès historiques, tels les procès Barbie ou Touvier, il est vrai qu’il ne faut pas trop demander à la justice. D’autant plus qu’après la cascade de plaintes, nous allons très probablement constater l’immense déception de leurs auteurs, quand ils verront qu’elles n’auront même pas été examinées… Des propositions ont été faites, des pistes ont été esquissées, mais tout reste à construire quant à une commission à imaginer, l’une des difficultés étant qu’elle devra nécessairement avoir un aspect bilatéral et associer des Français et des Algériens.